GRAND FORMAT – CENTRAFRIQUE : LA VIE AU PLUS PRÈS DES HABITANTS DE BAMINGUI, DANS LES ZONES OCCUPÉES

A Bamingui, situé à 550 km au nord de Bangui, la liberté d’aller et venir est restreinte et payante. La vie se déroule à la cadence du bien-être de ses envahisseurs depuis le 17 décembre 2012. Sous les chaussures et les sabots « selekistes », la terreur est quotidienne. Les tortures et la frustration aussi. Les biens de la population extorqués. Les pénuries alimentaires se sont installées. Les carences et les maladies ont épuisé les plus vulnérables. L’éducation scolaire s’est estompée. Les taxes et les amendes pleuvent. Les jeunes filles et femmes, véritables proies sensuelles, alimentent et assouvissent leurs appétits sexuels. La délation et la collaboration s’activent pour s’octroyer la bienveillance de l’occupant. Cet assujettissement à durée indéterminée, bouleverse et empoisonne inexorablement l’ordinaire des habitants de Bamingui. La République Centrafricaine n’y existe plus. Le havre de chaleur et d’humanité a disparu dans cet un océan de violence multiforme. Le quotidien est un défi.
Les prescriptions des occupants sont implacables
« Vous êtes chez nous. C’est nous qui faisons la loi ici. Descendez, tout le monde sous la paillotte ». Dans cette ambiance oppressante, Bamingui, accueille l’arrivée de ses hôtes. Un camion de marque Mercedes Benz stoppe net sous un ciel orageux, devant la barrière érigée par les éléments de la coalition seleka à l’entrée de la bourgade. Il est environ 15 heures. Les voyageurs, hommes, femmes, enfants et commerçants descendent les uns après les autres soutenus par les bras des apprentis-chauffeurs « bata-koungba » en sango, langue nationale. Tous couverts de poussière imbibée de sueur, lassés par ce long voyage, se dirigent, en file indienne, sous les ordres de Moussa, un combattant de selekas grand, émacié, aux allures d’un « poilu indigène » de 14/18, vers la paillotte.
Pendant ce temps, un autre élément, portant un chéchia sur sa tête dégarnie, chemise rayée maculée de taches indescriptibles, de chaussures usées par l’âge, d’un pantalon type multicolore, portant en bandoulière des cartouches et son arme, kalachnikov, à la main, mastiquant de la kola, marmonne : « Nous allons fouiller le camion». Ce qui fut fait minutieusement sans tarder. Chaque voyageur doit verser une somme comprise entre 1500 et 10000 francs cfa (2,30 et 15,24 euros) selon son status social. Les bagages et les marchandises tombent sous le coup d’une taxe douanière. Un impôt per capita imposé à l’entrée et à la sortie de la ville. Les prescriptions des occupants sont implacables et ne sont pas du genre à être négociées. Elles ont la priorité absolue sur toutes les autres exigences.
Les gens ont peur d’elle. Elle est souillée par le sang
L’unique grand axe, la RN 8, qui traverse avec ses poussières roues argentés qui porte en elle toute l’histoire de la ville. « Vous voyez cette route, lance tristement un vieux paysan, probablement un sage du quartier, elle a de l’histoire à raconter. En elle, sont concentrés les aller et venus des piétons de toutes origines et de toutes conditions, les joies, les éclats de rires. Elle connaît d’innombrables roues de camions, des vélos chargés des pacotilles des commerçants ambulants, des mobylettes. Aujourd’hui, elle est déserte inanimée. Les gens ont peur d’elle. Elle est souillée par le sang », conclut-il sans espoir de lendemain. Cette route abrite les boutiques alignées de par et d’autre jusqu’au marché.
Le marché a perdu son âme. Celui qui, autrefois, rassemblait une foule bigarrée, multicolore ; celui qui exhalait des odeurs fortes des fruits, du miel, des mangues ; celui qui envoûtait l’étranger par les effluves de sa faune ; celui qui entremêlait la senteur des viandes, poissons frais, séchés, boucanés, des légumes variés et tubercules sauvages, s’est anémié. Les étalages manquent de produits de premières nécessité, sucre, sel, farine, savon. Les commerçants ne peuvent se ravitailler. Les habitants se retournent vers la fabrication du savon traditionnel à base du beurre de karité, du sel de traditionnel…
J’attends mon tour. Je reste ici jusqu’à ma mort
Les populations des 5 principaux quartiers, BALEANGBA, GUIRA, BORNOU, YANDA et DABOU se sont enfuies en brousse pour échapper aux exactions des envahisseurs. Le rocher Gbouloukou dressé tel un veilleur, fierté de la ville et de ses 3000 âmes vivantes, est désormais orphelin. Il domine une ville morte, une ville assiégée qui vit des heures, des jours et des nuits épouvantables. « Avec la guerre, la ville a été vidée de sa population. Pendant près de deux mois les gens ne vivaient que dans la brousse dans des conditions de vie insupportable. Les gens ont perdu leurs réserves agricoles. Certains greniers ont été, soit pillés, soit saccagés ou simplement volés par les habitants restés en ville. Ceux qui ont leur petit élevage de volailles et de caprins les ont vus tués par ces malfrats, les rebelles. Certains champs ont été brûlés non seulement par le feu de brousse, mais par les rebelles », raconte une personnalité respectée de la ville qui a tout perdu et qui vit, désormais, avec sa famille dans une case à l’orée de la ville. « Je reste ici jusqu’à ma mort. Je serai enterré ici sur la terre de mon père et des mes aïeux. J’attends mon tour », ajoute-t-il larmoyant.
Je n’ai plus de semence, même si je cultive un champ
Dans le quartier Dabou, un père de famille nombreuse qui s’apprête à s’enfoncer dans la brousse pour des cueillettes en cette saison pluvieuse, interpelle un agent de Produits Alimentaires Mondiales (PAM) : « Mes réserves agricoles, mes semences ont été aussi utilisés comme ration pour nourrir les selekas qui faisaient irruption chez moi. J’en faisais profiter les voisins, les autres déplacés dans le même campement que moi en brousse. Que faire maintenant ? ». L’agent, surpris pas cette question, reste sans voix. « Les ménages manquent d’ustensiles, de literies, et des produits PAM », commente un agent d’une autre ONG démunie. Une vie de bête. Les cultivateurs souffrent aussi du passage des peulhs en transhumances avec leurs troupeaux de bœufs dans les champs de culture vivrière. « Les vaches ravagent nos champs. Les éleveurs peuhls, amis des selekas, nous demandent de souhaiter bon appétit aux troupeaux. Personne ne peut s’opposer car tous ces peulhs transhumants ont chacun une arme de guerre », clame un groupe de paysans du quartier Guira réunis pour conduite à tenir. Les habitants sont résolus à vivre de fruits et racines sauvages, à se « serrer davantage la ceinture », à vaincre la faim en buvant de l’eau, souvent non potables. La survie vient du soutien familial et de la solidarité des uns et des autres. Dans ces conditions, femmes et enfants, couples vulnérables, les personnes âgées sont les premiers à subir les affres de cette occupation, de cet abandon de l’autorité de l’Etat.
Les mêmes pensées, les mêmes questionnements se déclinent chaque jour leur dans leurs gestes : Que deviendrons-nous ? Sortirons-nous un jour de ce cauchemar ? Pourquoi Bangui ne vient pas à notre secours ? Pourquoi, pourquoi…. Nous, esclaves et prisonniers dans notre propre ville ? Tant de questions sans réponse dans les cœurs, dans les têtes de ces habitants loin des tractions politiques de Bangui.
L’Etat a disparu, les sélékas sont juges et possesseurs de l’économie
L’avènement des selekas a détruit le peu de tissu économique et financier qui rapportait des ressources dans les caisses de la commune de Vassako (Bamingui) et de l’Etat représenté par son agent spécial de trésor. Il a précipité les populations déjà pauvres dans la misère. La majorité analphabète n’a pas mesuré la conséquence de ses actes en pillant les 4 sociétés que disposent Bamingui : Centrafrique SAFARI, SAFARI NGOUASSA, SAFARI NGASSA et SAFARIA qui a trois camps très réputés (FÔ, KOZO et AYIWAMBA).
L’Eco Faune, et ces Safaris lui procuraient des embauches, des aides sociales et de revenus financiers. « Le projet Eco faune à travers la ZCV (Zone Cynégétique Villageoise), et les safaris versent des taxes à l’Agence Spécial, s’occupe aussi de la construction des écoles villageoises, du paiement des salaires des maîtres-parents, des ouvriers municipaux, alimente les villages en eau potable, (on y compte 3 forages), crée des postes de santé dans les villages cynégétiques », ose s’exprimer le maire de Vassako au bord de la crise de nerf.
Les bâtiments de l’école sous-préfectorale et du collège sont réquisitionnés pour abriter les rebelles selekas. Un groupe est basé à la gendarmerie. Les chefs selekas ou comzones ont élu domicile dans la résidence du sous-préfet. Les bâtiments officiels, s’ils ne sont saccagés, sont occupés illégalement. Les fonctionnaires chassés de leur logement de fonction, ont déserté les lieux. Les belles demeures sont devenues les fiefs de ces envahisseurs. « ils rackettent la population. Tous les ménages doivent contribuer en nature à leur alimentation. Les opérateurs économiques et la Mairie sont tenus de leur verser des sommes d’argent hebdomadairement en fonction de la taille de leurs commerces. La population vit avec la peur au ventre évite d’avoir des différents avec eux » lâche un rescapé d’une des sociétés pulvérisées.
Un ancien garde de chasse, impuissant, livre ces dernières émotions et colère : « Du braconnage, du braconnage et du braconnage. Ils exterminent sans exception les animaux de notre faune. Les espèces protégés, éléphants, rhinocéros, girafes, panthères, vont disparaître à tout jamais ». La prédation s’est installée à tous les étages tant à Bangui en matière de détournement, que dans les villes et villages de Centrafrique en matière de ressources naturelles. Les comzones, toujours en activité, détruisent et vident le pays de ses richesses devant les vrais garants de pouvoir : l’agent de l’Etat.
Ils sont braconniers, notables, arbitres des litiges, douaniers, gendarmes, policiers. Ils font et défont les taxes. Ils font justice eux-mêmes. Les populations excédées ne comprennent pas le fondement de leurs lois, de leur procédure pénale expéditive et les tortures inhumaines. Ils tiennent en mains les ressources économiques de la ville et font un véritable obstacle à l’administration.
Si tu tombes malade, tu meurs
Les postes de santé n’existent plus. Le dispensaire opérationnel n’est pas équipé. « Il n’y a pas des appareils pour des examens médicaux, ni certains médicaments de base. Les évacuations sanitaires sur le centre de N’délé se fait en Moto, très pénible pour le patient mais aussi pour le conducteur vue l’état dégradé de la route. Parfois le patient succombe en route. Le taux de mortalité infantile est très élevé dans la ville et les villages environnants », s’insurge un infirmier accaparé à soigner la blessure d’un jeune homme qui vient de recevoir une balle dans les jambes. Plus tard, l’agent de santé rapportera que le jeune homme a flirté avec une fille convoitée par un élément séléka.
On n’a jamais travaillé comme ça, comme des animaux
Les réquisitions, les harcèlements physiques et moraux, la peur, la destruction des biens, les viols ont contraint la population à se réfugier dans les champs dévastés. Confrontés aux manques de vivres, les éléments de la seleka sont allés les obliger à revenir alimenter la ville en denrées alimentaires. Toutefois, la peur des représailles pousse certains habitants à la collaboration, au dénigrement, pour s’offrir une estime, une petite chance de survie, une infime partie de liberté. Ce qu’un maître-parent du quartier YANDA redoute et commente « Ils nous divisent pour régner sur nous, pour nous affaiblir».
Les contrôles et les fouilles au corps, sans raison, déshabillent l’intimité de ces hommes et femmes, les privent de leur dignité devant leurs progénitures. Les ordres à respecter et les irruptions intempestives de l’occupant dans leurs gestes, dans leurs regards sont autant des fardeaux lourds qui les fragilisent. Les détonations des armes augmentent leur angoisse.
Entre ce que les habitants appellent « il faut loger les selekas, c’est-à-dire l’occupant, le nourrir, l’abreuver, le vêtir, le soigner, le distraire, lui réquisitionner une femme pour la préparation de la « douma, de la bili-bili » et la distillation de l’alcool (ngbako, ngouli) », les femmes et les jeunes filles sont de véritables bêtes de somme. Elles sont cuisinières, porteuses d’eau ou objets de distraction. « Je porte de l’eau à longueur de journée. Les autres sont dans la brousse pour chercher des fagots pour la cuisine. On n’a jamais travaillé comme ça, comme des animaux » explique une jeune fille en pleurant.
La population de Bamingui est exténuée. Malgré les petits soins, elle reçoit des coups de martinets ou de cross de kalachnikov « kala » sur la tête, la poitrine ou dans le ventre déjà affamé, si le bourreau est raisonnable. Véritable esclave, elle ploie sous les conditions de vies inhumaines imposées par les rebelles.
Elle dilue sa souffrance dans ses larmes.
Elle n’a jamais rêvé de telles souffrances, les sélékas lui en offrent.
Joseph GRÉLA
Commentaires
0 commentaires
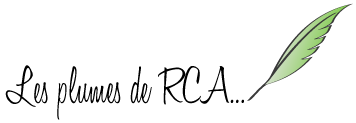




Cela donne envie de gerber …C’est profondément bouleversant un tel tableau ; et pourtant on croyait l’esclavage aboli …