Extrait de souvenirs de l’école indigène : Le départ pour l’école

Dans un coin de la maison réservé aux volailles, les poules gloussèrent, les poussins pépièrent et troublèrent notre sommeil pendant que nous planâmes dans nos rêves oniriques de jeunes enfants. Les deux coqs que m’avaient offerts mes oncles maternels lors de leur passage au marché du centre de la ville, se mirent à chanter et à battre les ailes dans cette obscurité muette, envoûtée par des fantômes, mêlés aux âmes des aïeuls, venus rendre visite aux vivants endormis, usés par les labeurs de la journée. Ces coqs étaient notre radio-réveil. Il était donc 5 heures du matin.
Réveillés en sursaut, mon cousin Toéta plus âgé, et moi quittâmes précipitamment chacun sa natte, l’enroulâmes et la posâmes dans un lieu habituel de la maison. Nous pliâmes ensuite tant bien que mal le tissu « americani » nous servant de drap ou de couverture, le rangeâmes sur nos valises cartonnées posées sur un tabouret.
Ce matin là, je gémis devant ma grand-mère, ma tutrice : « Je suis fatigué, je suis très fatigué, et puis je ne veux plus aller à leur école », leur école indigène, leur école rurale. « Je suis fatigué. Mon père m’a quitté » feignis-je, en laissant sillonner quelques larmes dans le creux de mon visage. « Il ne reviendra plus, me souffla-t-elle, d’une voix tendre, dans l’oreille. Il ne reviendra plus, il est parti loin, très loin au pays de non retour.» Pour me consoler, elle m’assura, convaincue, que mon père allait se réincarner et renaître ailleurs, dans une famille, sous d’autres horizons. Je n’avais pas encore compris que j’étais, à cet âge, orphelin pour toute ma vie. Pour moi, seule, l’école était l’instrument qui changerait ma condition de vie. « Seule l’école peut propulser un enfant, loin dans ce pays là-bas, là-bas au pays des blancs » me racontèrent les vieux du village.
Dehors, déjà le premier groupe d’écoliers étaient en route pour l’école. Vite de l’eau dans une calebasse, je me lavai passablement la figure, mes bras et mes jambes, enfilai mon tee-shirt maculé par endroit par de sèves de manguiers et autres arbres fruitiers, ma « culotte », entendez, bermuda, sans dire « bonne journée » à ma grand-mère, me voici sur le chemin de cette école de brousse.
Mais à présent, à quoi servit l’école, cette école de Bakouté située à 5 km du village, si ce ne fut le serpent noir du maître ? Et puis tous les jours, je dus rejoindre le groupe des premiers élèves qui passèrent, courir, mes cahiers, mon morceau de tubercule de manioc pour le goûter, sous le bras, dans un nylon, ah ! Non ! Dans un sachet en plastique. Je dus courir, suivre les pas des grands, ces « goyos » du CM2, nos veilleurs.
Ces goyos, nos grands-frères qui ne voulurent perdre un élément du groupe en chemin. Ils furent les tuteurs des petits. Ces goyos qui nous rappelèrent régulièrement à l’ordre. Ils marchèrent, marchèrent vite en chantant, en récitant les leçons, pour les uns, les récitations, tirées du livre de français à l’usage des écoles africaines « Mamadou et Bineta » pour les autres. Nous marchions, avancions vers cette école, pieds nus, les talons durcis, brûlés par la chaleur quotidienne du soleil et brunis par la poussière couleur latérite.
La bise matinale nous lécha le visage dans cette course vers l’école. « Ecartez-vous », lança Ngala Toéta, mon cousin qui fit partie des influents du groupe. Aussitôt tous s’écartèrent au passage du landrover, véhicule de commandement du sous-préfet « Alpaga », ce pantalon large de la hanche au talon qu’il aimait porter. De la poussière sèche s’éleva et nous enveloppa. Elle se colla à notre peau noyée de sueur et la transforma en couleur rouge-brique. Mais nous criions joyeux à la vue de véhicule sur cette route jamais entretenue et rarement empruntée par les « camions ». Alpaga, dis-je, fut ce jeune sous-préfet fraichement sorti de l’ENA et craint des villageois.
Nous courûmes alors, vers cette école rurale, école de Brousse, école indigène où nos parents nous poussèrent pour devenir un jour comme les « monsieur de la ville au col blanc, les mounzous voukos », qui habitaient, comme de blancs, dans des maisons en tôle. Les feuilles mortes des tamariniers, des « birlos », gros arbres des savanes aux épaisses écorces, souffrirent et craquèrent sous nos pas de marathoniens.
Tel un troupeau de bœufs, par ce petit matin du mois de novembre, frais, très frais, nous nous hâtions vers cette école. Le soleil fut déjà haut dans le ciel. Le groupe fut-il en retard ? Nous sûmes l’heure selon la position du soleil. Il ne fut pas encore 7h30, l’heure de se mettre en rang devant chaque classe. A chaque traversée des villages, nous fûmes accueillis par les aboiements des chiens galeux, malingres, émaciés qui nous poursuivirent. Des moutons, des brebis et des cabris qui n’eurent pas fini leur nuit, bêlèrent, gambadèrent, galopèrent pour quitter le chemin à l’approche du groupe qui grossit au fur et à mesure de son avancée.
Au loin, les premiers coups la cloche de l’école, une jante de voiture récupérée chez le mécanicien de la ville proche, retentirent. Aller, le groupe redoubla de la vitesse. Il ne fallut pas être en retard. Le maître de la semaine fut Monsieur Pierre. Monsieur Pierre fut aussi le maître des CE1. Il était très méchant dans notre langage de « primairiens », écoliers du primaire. Mais en fait, il était rigoureux et sévère. Il attendit les retardataires à l’entrée de la concession de l’école. Avec son « serpent noir » dans la main, prêt à mordre les mollets des élèves récalcitrants. Ouf, aux deuxièmes coups de cloche, nous arrivâmes, inondés de sueur devant l’entrée de l’école.
Monsieur Pierre n’était pas encore là, devant l’entrée mais déjà sa voix fendit l’air pour nous pousser dans les rangs « Dépêchez-vous, vous êtes en retard !» Nous n’eûmes pas le temps de déposer nos cartables, nos sachets en classe. Nous les déposâmes aussitôt à même le sol. Et chacun rejoignit ainsi ses camarades de classe déjà, alignés comme des bidasses, des plus grands aux plus petits, marchant, chantant gaiement pour se rassembler au pied du mât portant le drapeau bleu, blanc vert jaune rouge, couleurs de Centrafrique, frappées d’une étoile jaune. Nous fûmes prêts pour saluer le drapeau. « Silence », s’époumona Monsieur Pierre, « Autant ! Fixe ! Autant ! Fixe ! Gauche ! Gauche ! Repos ! Gardavou ! Repos ! Gardavou !». Aucun écolier ne toussa ni murmura en ce moment-là, silence religieux, car le serpent noir de Monsieur Pierre qui ne le quittait jamais, guettait. Ce serpent noir issu d’un morceau de pneu de voiture mesurait environ 60 cm. Nous voici, tous autour du mât, blottis, cristallisés, bras collés le long du corps, regards figés dans la direction de l’élève de service qui hissa le drapeau. Tous les passants s’arrêtèrent. Les femmes chargées restèrent immobiles sous le poids de leur cuvette de manioc, du mil ou d’arachide ; les bébés dans leur kangourou pleurèrent à se fondre les yeux. Les vieux se tinrent courbés sur leur canne et attendirent écouter nostalgiquement les élèves chanter, mieux brailler ou massacrer la Renaissance qui leur rappela Boganda, le fondateur de la nation et compositeur de l’hymne et de la devise. « Ô Centrafrique, au berceau des bantous », entonna Monsieur Pierre, en français, car dans la cour de l’école, ni le sango, ni les langues vernaculaires ne furent autorisées. Contrevenir fut synonyme de punition : Port d’un collier en os toute la journée. L’on devint alors objet des railleries des camarades. « La devise de notre pays, la République Centrafricaine », ordonna-t-il, solennellement. En chœur, nous mâchions «Unité-Dignité-Travail ». « La devise de notre école » enchaîna-t-il. Ensemble, nous clamions : « Ponctualité-Discipline-Travail ». « Rompez les rangs » s’égosilla-t-il enfin pour que, dispersés en petits groupes, nous ramassâmes les rebuts et les feuilles mortes, dans la cour de l’école, déposés le vent.
Monsieur Pierre, dans son ensemble bleue-marine « tenue directeur » impeccablement repassé par son boy, la veille, sa paire de chaussures « baron méchant » rouges-bordeaux parfaitement cirées, cheveux noirs, luisants grâce à de la « brillantine » et soigneusement peignés, barbe irréprochable, yeux pénétrants, veilla consciencieusement à la propreté de la cour de l’école. D’ailleurs, il y trouva souvent une raison de se dégourdir les bras au moyen de son serpent noir sur un impoli, un élève désobéissant, lent au ramassage et bavard. Monsieur Pierre était jeune, grand, beau et à la fois notre idole. On l’aimait, Monsieur Pierre. Il fut notre maître en classe et notre maître dans la vie. Il avait des yeux partout, Monsieur Pierre. Il entendit tout. Il lui arriva de se servir de son sifflet pour rassembler les élèves. Evidemment les trainards, son leitmotiv, reçurent les morsures du serpent noir.
Nous nous attendîmes, devant notre classe respective en rang, notre maître qui vint nous faire entrer. Mais avant, il nous inspecta les ongles, les dents, les yeux, les oreilles. Nos cheveux devaient être courts ou rasés. Pour les filles, les cheveux devaient être tressés, sinon elles devaient porter le « silk », le foulard communément appelé mouchoir de tête. Il examina aussi nos pieds, nos orteils, le col de notre chemise, puis en file indienne nous rentrâmes en classe. Nous le saluames en chœur : « Bonjour Monsieur » avant de nous asseoir enfin, et de suivre l’emploi du temps de la journée.
J’étais au CE1. Mon école était un grand hangar. La charpente et le toit en paille tenaient sur des piliers en bois, amis des termites. Ce hangar-école fut divisé en trois classes séparées par un mur en joncs tissés, serrés qui accueillirent les six niveaux : CI et CP, CE1 et CE2, CM et CM2. Un grand tableau, noirci avec de l’ardoisine ou à défaut noirci avec un mélange de feuilles de patates douces écrasées et du charbon de bois réduit en poudre, posé sur un chevalet au milieu de la classe, à côté du bureau du maître. De petits troncs d’arbustes soutenus par deux piquets enfouis dans le sol, nous servirent de bancs. Deux autres piquets, plus hauts, supportaient une planche brute de 15 cm environ de large servit de table. Le sol était en terre battue. Nous respirâmes cet air poussiéreux au moindre coup de vent, le maître et nous-mêmes.
L’équipe enseignante nous libérait, par sécurité, en cas de grands vents, des tornades ou de pluies souvent torrentielles. Le toit suintait par endroit. Ce hangar-école, abri des termites, construits à la hâte à la rentrée scolaire, des mains de nos « ingénieurs architectes indigènes » s’écroulait souvent. Aussi, à la saison sèche, soufflé par les feux de brousse environnants, le hangar partait en cendres. Nous nous retrouvâmes ainsi à l’ombre des manguiers ou des kapokiers en plein air, les cahiers sur les genoux pour suivre l’enseignement du maître.
L’apprentissage de la citoyenneté et des règles de la langue du blanc de la France fut au prix de ces sacrifices.
La sœur du maître des Diallobés dans l’aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, La Grande Royale proclame : « Ce que je propose, c’est que nous acceptions de mourir en nos enfants et que les étrangers qui nous ont défaits prennent en eux toute la place que nous aurons laissée libre […] Nos meilleures graines et nos champs les plus chers, ce sont nos enfants ».
Poussons-les vers l’école.
A suivre…
Joseph GRÉLA
L’élève du cours moyen de l’école de brousse
De Bakouté
Commentaires
0 commentaires
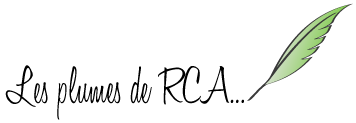
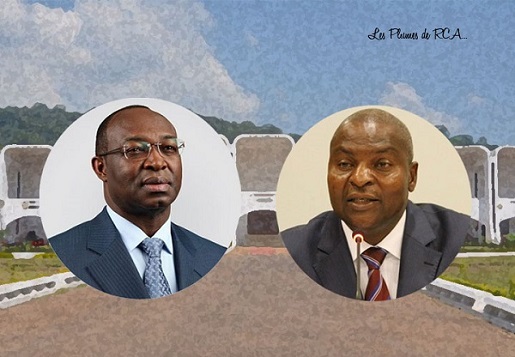



Joseph, tu as fait du bon travail. Je n’aurai pas imaginé ça de toi.
C’est très réfléchi et captivant de par son intellectualisme, sa philosophie, son sens du devenir de l’être humain aussi petit voir minuscul soit il. L’école, c’est l’émancipation, c’est la porte de sortie de l’indigénat obscure qui en réalité entraine l’humain vers une idiotie sans précédent.
Comme a dit Enza, une mauvaise écriture entraine une mauvaise lecture. Telle est l’héritage laissé par nos soit disant anciens dont l’école n’a pas été le leitmotive.
Ô « planche »,posture disciplinaire où les « grands »nous tenaient les bras et les jambes afin de subir le seigneur « Serpent noir »,cette lanière de pneu qui devait éveiller en nous le dur passage de l’ignorance au savoir.
Pis,en province(dans les années 62-63) à Monguomba,il incombait à l’élève d’aller chercher le meilleurs branchage à sa sanction:le meilleur était les branches de « mbororo »ou de caféier.
A l’école Jean Colomb de Ngaragba,j’ai une pensée pour mes instituteurs : M. Mbamaïba, M.Akekelelo……., qui nous avaient appris que porter en collier le crâne desséché de caprin autour du cou lorsqu’on a commis une faute de français en parlant avec les camarades dans la cour était un rituel à la Maîtrise de la langue française,qui dis-je de la langue de Vauvenargue,comme nous nous plaisions à le dire alors!
Joseph, traumatisé donc ? Non,parce qu’il a persévéré pour prendre l’ascenseur social qui est l’école afin de nous offrir au passé simple, ce vécu!
Il y a eu des condisciples qui n’ont pas pu tenir la longueur et je les comprends,mais nous qui avons pu tenir le coup,nous sommes là aujourd’hui pour porter témoignage.
Je forme le vœu qu’ en Centrafrique l’école républicaine reprenne le dessus sur les écoles privées,le plus souvent mercantiles et non formatrices de citoyens et d’amener les élèves au savoir ,à la connaissance…
je suis triste à l’idée de devoir penser que l’école au sens globale se serait arrêtée à la fin des années 70!
Merci Joseph de ce tango ya ba wendo!!!