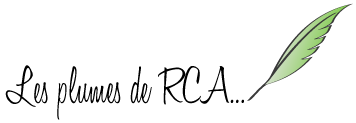LE COSMOS NOUS RÉUNIRA

De Michel ONFRAY
Mon père est mort dans mes bras, vingt minutes après le début de la nuit de l’Avent, debout, comme un chêne foudroyé qui, frappé par le destin, l’aurait accepté, mais tout en refusant de tomber. Je l’ai pris dans mes bras, déraciné de la terre qu’il avait soudainement quittée, porté comme Énée porta son père en quittant Troie. Ensuite, je l’ai assis le long d’un mur, puis, quand il fut clair qu’il ne reviendrait pas, je l’ai allongé de toute sa longueur sur le sol, comme pour l’aliter dans le néant qu’il semble avoir rejoint sans s’en apercevoir.
En quelques secondes j’avais perdu mon père. Ce que j’avais si souvent craint était arrivé, en ma présence. Je ne suis jamais parti donner des conférences en Australie ou en Inde, au Japon ou aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en Afrique noire sans penser au fait qu’il aurait pu mourir pendant mon absence. Je songeais alors avec effroi qu’il m’aurait fallu faire un long retour en avion vers lui en le sachant mort. Or, il mourrait, là, avec moi, dans mes bras, seul à seul. Il profitait de ma présence pour quitter le monde en me le laissant.
Longtemps vieux garçon, mon père le fut tardivement, à l’âge de trente-huit ans. Quand j’avais dix ans, il en avait donc quarante huit, cinquante-huit quand j’en avais vingt, autant dire, dans le regard des enfants et des adolescents de mon âge, un vieux monsieur qu’en pension mes congénères prenaient parfois pour mon grand-père. Souscrire à ce regard des autres qui en faisaient mon grand-père et non mon père, c’était le trahir ; n’y pas souscrire, c’était être un fils de vieux – comme le disent les enfants qui évoluent dans la cruauté tel un piranha dans l’eau. Avoir un père âgé oblige, jeune, à faire face à la méchanceté de ses semblables ; plus tard, on comprend que ce fut une chance, un cadeau. On découvre alors qu’on a un père sage, posé, calme, serein, débarrassé des afféteries des jeunes années, ayant assez vécu pour n’être plus dupe des miroirs aux alouettes clignotant partout dans la société.
Je suis devenu le fils de mon père quand j’ai compris qu’il vivait sa vie sans se soucier de correspondre aux modes qui voulaient alors des pères modernes, des pères habillés avec les mêmes vêtements que ceux de leurs enfants (shorts ou baskets, chemises bariolées ou tenues de sport), des pères parlant la même langue relâchée qu’eux, des pères copains, complices et rigolards, des pères potes, des pères avachis, des pères enfants ou adolescents, des pères pas finis… Ma chance fut d’avoir eu un père comme ils existaient avant qu’ils ne deviennent les enfants de leurs enfants.
Mon père avait des vêtements de travail et des vêtements du dimanche. La mode ne faisait rien à l’affaire : le bleu de travail, le lustré et l’odeur de la moleskine qui délavait avec le temps, la casquette, le pantalon, la veste en harmonie de couleur avec ses yeux. La panoplie du dimanche était simple et modeste : pantalon, veste, chaussures, pull à col en V, cravate. La semaine, pour le travail, une montre à gousset ; le dimanche, une montre-bracelet. Pour « le tous les jours », les odeurs de la ferme qu’il portait avec lui, parfums heureux les temps de moisson, moins les jours d’épandage. Le dimanche, le sent-bon, une eau de Cologne simple frictionnée après rasage dans l’évier de la cuisine – nous n’avions pas de salle de bains.
Sans le savoir, il m’apprenait ainsi, non par des leçons ostentatoires, mais par l’exemple, que le temps dans lequel il vivait était celui de Virgile : le temps du travail et le temps du repos. Insensible aux temps de la mode, temps modernes et temps pressés, temps de l’urgence et temps de la précipitation, temps de la vitesse et temps de l’impatience, tous temps des chosesmal faites, mon père vivait un temps contemporain des Bucoliques, temps des travaux des champs et des abeilles, temps des saisons et des animaux, temps des semailles et des récoltes, temps de la naissance et temps de la mort, temps des enfants bien présents et temps des ancêtres disparus.
Rien n’aurait pu le faire déroger de ce rapport au temps dans lequel les anciens tenaient une place prépondérante, plus que certains vivants même. Il n’avait pas le culte de ses parents ou grands-parents de façon fétichiste et larmoyante, mais, parlant de son père, quand il lui arrivait de dire le père Onfray, on sentait qu’il rapportait d’antan une parole autorisée, une parole lourde et forte, puissante, une parole contemporaine de l’époque où les mots avaient un sens, les paroles données valeur de serment et les choses dites force de loi. Mon père qui parlait peu quand j’étais enfant m’a appris ce que parler veut dire.
Extrait de Comos
Commentaires
0 commentaires